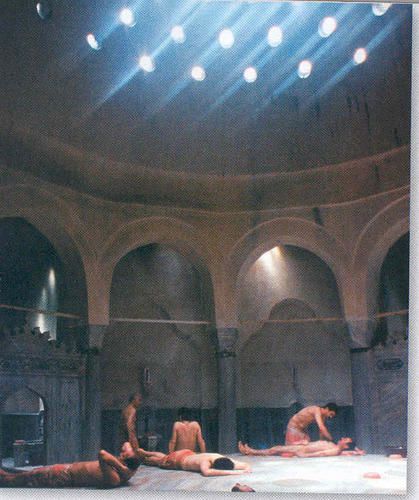18 novembre 2007
7
18
/11
/novembre
/2007
00:00

« Voici ta chambre ! Ici, tu es chez toi ; ton travail est simple : tu t’occupes du ménage et de la cuisine, et de temps en temps tu descends mettre un peu d’ordre au bureau. Tiens ! Prends cet argent pour régler tes dettes et acheter des jouets pour les enfants, je vois qu’ils s’ennuient ».
Quand elle entendit ces phrases, Rachida crut qu’elle rêvait. Elle ferma les yeux puis les rouvrit et retrouva la dame qui venait de la délivrer au même endroit. « C’est donc vrai », faillit-elle s’écrier de joie. Elle prit les billets de la main de sa bienfaitrice et, les larmes aux yeux, articula : « Merci ! Votre geste est venu à point ».
Avant que naisse ce jour que le Destin désigna pour la soustraire à sa misère, Rachida n’avait jamais réellement désespéré. Certes, elle ne s’attendait pas à ce qu’une femme inconnue allait la cueillir d’un champ sec et brûlant où elle arrivait juste à vivoter, pour l’accueillir et la replanter dans une terre fertile, aux coté d’un cœur qui ne respire que générosité et propulse dans un sourire printanier les bourgeons de la bonté. Elle ne s’attendait pas que sa situation changerait subitement. Cependant, elle sentait au fond d’elle que la période difficile qu’elle traversait n’était que passagère. Rachida en était certaine. Et sa certitude l’avait encouragée à affronter toutes les adversités qui se succédèrent après le décès de son mari. Elle travailla dur pour nourrir ses deux enfants. Elle encaissait sans broncher les insultes de ses patrons et leurs injures, parce qu’elle savait que son esclavage n’était pas éternel. Sa souffrance avait atteint l’extrême et tout ce qui pourrait advenir après ne serait que moindre. Même s’il n y avait pas cette consolante lueur d’espoir qui gonflait son cœur d’ardeur, de patience, et lui faisait oublier la souffrance où elle baignait, Rachida n’aurait guère osé manquer de respect à un patron ou une maitresse de maison. Elle ne réagissait pas tout de suite à leurs reproches quoique très irritants et souvent irraisonnés. On l’accusait de négligence pour avoir seulement omis de vider un cendrier ou essuyer une vitre dans un coin oublié. Elle se taisait. Elle ravalait à contre cœur la salive qui s’unissait dans sa bouche, s’efforçait de lui échapper et aller s’éclabousser sur la figure qui l’engueulait. Elle ravalait les mots qu’elle savait soulageant mais ne pouvait pas les prononcer. Elle n’avait pas le choix et devait tout endurer, car un mot déplacé de sa part le matin, risquait de priver ses enfants de diner le soir. Les enfants, insouciants, rappelleraient alors à leur mère son devoir. Ils exigeraient que la nourriture soit prête au moment où se manifeste leur besoin de manger.
Malgré son obéissance et sa docilité, Rachida fut successivement renvoyée par trois employeurs. La femme qui l’engagea dès ses premiers jours de veuvage se plaignit de la présence permanente des ses enfants. Son second patron, un jeune homme sympathique lui expliqua que sa femme la trouvait trop jeune ; il la recommanda alors à un ami de son père, un retraité de l’armée qui avait choisi de finir ses jours en solitaire.
D’abord, le retraité accueillît Rachida avec une grande joie. Une joie qu’il exprimait en reconnaissant que son habitation avait justement besoin d’un souffle juvénile, d’une certaine vivacité. Il avouait qu’il aimait se rappeler les bruits des ustensiles de cuisine manipulés par les mains habiles d’une femme. Ainsi, pensait-il, ralentir l’avancée de la vieillesse qui se creusait, rides haïssables, sur son visage ; sa maison ne ressemblerait plus à une tombe, et il ne serait plus le corps sans âme qu’elle abritait.
Mais ensuite, il la renvoya. Le nouveau maitre avait l’habitude de travailler dans une discipline sans faille à la caserne, de se faire obéir. Trop obéir. La soumission de la jeune femme était imparfaite. D’ailleurs, elle ne semblait pas saisir le sens de son langage devenu au fil des jours plus explicite. Il trouvait qu’il n’avait pas tort de l’accuser de désobéissance et d’incompréhension. Il jugea même qu’elle méritait plus que le renvoi. Car elle osa défaire le monde de rêves que lui avait procuré sa solitude, sans apporter de contre partie. Il vécut alors la douleur profonde d’un jardinier qui voit ses fleurs piétinées par une vache…tarie.
Après qu’elle eut quitté cette maison, Rachida ne pensa qu’à une seule solution pour face aux exigences pressantes de ses enfants : aller s’installer à la sortie d’une mosquée et tendre la main. Mendier. Pourtant, elle avait encore d’autres choix. L’épicier du quartier, quelqu’un qui connaissait bien son mari, lui avait assuré de lui servir tout dont elle aurait besoin. Mais elle eut peur de trop s’endetter puis dépendre de cet homme qui ne semblait nullement bon croyant, car son comportement, et la façon dont il lui proposa son aide trahissaient les pensées malsaines qu’il nourrissait.
D’autres gens étaient venus témoigner à la veuve leur amitié et lui prêter assistance. Elle ne pouvait admettre, cependant, que ceux-là allaient la prendre en charge, elle et ses enfants, pendant longtemps. Elle ne se trompait pas. Elle se retrouva seule. Tout le monde l’avait fuie. Elle ne reprocha rien à personne ; chaque individu a une vie à vivre, et pour ne pas l’affadir, il doit éviter de trop s’inquiéter des ennuis des autres. Qu’il attende ses propres ennuis ! Rachida trouvait cela raisonnable ; chacun doit se débrouiller.
Elle avait tenu tête à la misère. Elle se pointait après les prières à la sortie de la mosquée. Sa main et celles de ses enfants se tendaient, implorantes, s’adressaient au fidèles pour les apitoyer et éveiller leur générosité. Elle se sentait en cet endroit en sécurité ; nul n’osait l’offenser. Les maux terrestres ne se réinstallent ordinairement dans les cœurs des fidèles que longtemps après les prières.
Ce fut un coup de klaxon qui lui annonça la fin de ses jours pénibles. Elle pensa d’abord que ça provenait de la voiture de l’un de ces vieux hommes aux cheveux grisonnants, que la fortune avait rajeunis et emplis d’impudeur. Elle continua alors son chemin sans se retourner. Mais la voiture s’avança, s’arrêta à sa proximité. Rachida constata qu’une femme était au volant :
-- Montez ! l’invita l’inconnue, je vous emmène chez-vous.
-- Merci madame, dit Rachida, nous sommes presque arrivés.
-- Montez ! Je vois que les enfants sont fatigués.
Rachida hésita un moment, puis ouvrit la portière arrière, poussent ses deux garçons à l’intérieur de la voiture puis prit place à coté de sa bienfaitrice.
A suivre…